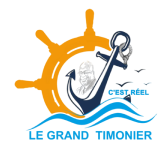La praxis doit toujours être précédée d’une bonne rhétorique. Cette dernière est le fruit d’une bonne réflexion. C’est l’exercice à laquelle se livrent les sociétés savantes, les think tanks et les groupes de recherches et de réflexion. Ils rassemblent généralement la crème de l’élite intellectuelle.Celle qui s’est décidée de jouer son rôle de boussole et de lumière de la société pour la guider, la sortir de l’obscurantisme, de son sous-développement et de tout ce qui peut l’empêcher d’avancer. Le Centre de recherche pour la promotion de l’économie coopérative, CERPEC, peut être compté parmi les asbls qui réfléchissent sur les clés pour le développement de l’Afrique et de la RDC.
Sa démarche commence par l’observation, l’examen de évolution de l’économie continentale et nationale et l’établissement d’un diagnostic. La mondialisation et ses acteurs n’échappent pas à son analyse ainsi que toutes les expériences passées du pays dans ce cadre. Le Congo-Kinshasa est, en effet, une petite économie ouverte vulnérable aux chocs extérieurs. Il n’est pas aussi à l’abri des chocs internes, conséquences de mauvaises décisions économiques prises par des autorités (comme on a pu le constater par le passé). Le coordonnateur technique du CERPEC, Albert Lutete, expert-comptable et inspecteur général des finances de son état, explique que la pensée sur l’économie coopérative commence par l’observation des structures de base de l’Afrique et de la RDC ainsi que des valeurs qui animent ses communautés comme la solidarité. Celle-ci cimente l’unité, le respect de l’autorité et la transmission de la culture et des valeurs positives de générations en générations. C’est de tout cela qu’émerge une identité.
Au plus lointain de l’histoire en Afrique, ces communauté ont comme partout ailleurs dans le monde chercher des solutions à leur subsistance. Les membres des villages et des clans ont vite compris l’importance de la mise en commun de tout ou d’une partie de leurs biens ou moyens de production. La solidarité n’est pas dans ce cas le fait d’un instant présent mais s’étale dans le temps. Au gré des événements, les membres de la communauté assiste tour à tour un des leurs à l’occasion des activités ardues des champs, de la construction de son habitation pour héberger sa famille après son mariage, etc. Cette culture de la solidarité rend presque naturelle le concept de coopérative. «Chacun de son côté, nous sommes faibles mais unis, nous sommes plus forts», pourrait-on dire. «La coopérative permet d’unir les bras mais aussi les têtes». «Ubuntu», ensemble, comme le diraient les sud-africains : «Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous» .
On imagine mal un pécheur seul en mer arriver à obtenir une grosse prise et même dans ce cas à tirer toujours lui-même sur le rivage un long filet de pêche. La coopérative s’impose donc une structure de fédération et de mutualisation des moyens de production pour une plus grande productivité. La réflexion et la conception passent très bien sur papier et peut-être aussi sur le terrain auprès des acteurs (agriculteurs, pécheurs, artisans, ….). Mais on ne peut pas en dire autant au niveau des autorités engluées dans une organisation bureaucratique éloignée des réalités vécues par les coopératives et leurs membres. La distance ou l’éloignement est multiforme. Spatiale quand les autorités sont dans les villes loin du monde rural. Conceptuelle, quand dans les ministères, on ne jure que par une agriculture ultra-moderne loin des réalités du paysannat. D’intérêts lorsque les décideurs ne prennent pas des décisions en faveur des petits exploitants regroupés en coopérative mais plutôt en faveur de grands producteurs agricoles sur lesquels ils tirent des avantages indus.
Ou encore les projets de développement agricole qui ne sont pas orientés pour la majorité des agriculteurs du pays comme les routes de desserte, la production et la fourniture de petit outillage, la facilitation de l’encadrement par les moniteurs agricoles. Politique, suite à une forte centralisation pendant que le développement de l’agriculture exige une gestion décentralisée au plus près des administrés. La coopérative, elle-même, est par nature une structure autogérée. Elle est en somme bien plus : une entreprise qui porte directement les aspirations de ses membres égaux les uns des autres. La FAO n’est plus enthousiaste pour le développement par les pouvoirs publics de grandes structures agricoles. Elle le tire de son expérience qui est du reste… mondiale. Asseoir le système coopératif devient donc un impératif pour les autorités du pays. Espérons qu’elles en prennent conscience. On pourra passer de l’idée, du concept à la réalité… pour le bien-être de 70% de la population congolaise.